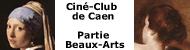|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

Après Van Gogh et Picasso, Rembrandt est l'un des peintres les plus représentés au cinéma. Il l'est dans des biopics : Rembrandt (Alexandre Korda, 1936), Rembrandt (Hans Steinhoff, 1942), Rembrandt Fecit 1669 (Jos Stelling, 1977), Rembrandt (Charles Matton, 1999) mais aussi dans la mise en scène de son tableau le plus célèbre ainsi : La ronde de nuit (Gabriel Axel, 1978), La ronde de nuit (Peter Greenaway, 2007) et la magnifique partie qui lui est consacré dans Passion (Jean-Luc Godard, 1982).
Plus rare est la représentation de tableaux postérieurs à 1642 alors qu'il reste encore 37 ans à peindre pour Rembrandt. Ces tableaux sont alors montrés comme un goût personnel du réalisateur ou pour évoquer leur valeur marchande.
Films présentant des tableaux de Rembrandt
| Rembrandt | Pierre Schoeller | France | 2025 |
| Spot of the 22nd Ji.hlava IDFF | Jean-Luc Godard | France | 2018 |
| La ronde de nuit | Peter Greenaway | France | 2007 |
| Rembrandt | Charles Matton | France | 1999 |
| Haute voltige | Jon Amiel | U.S.A | 1999 |
| Passion | Jean-Luc Godard | France | 1982 |
| La ronde de nuit | Gabriel Axel | France | 1978 |
| Rembrandt Fecit 1669 | Jos Stelling | France | 1977 |
| Les carabiniers | Jean-Luc Godard | France | 1966 |
| Rembrandt | Hans Steinhoff | U.S.A | 1942 |
| Rembrandt | Alexandre Korda | France | 1936 |
1 - Les biopics
Pour François Genton 1, Rembrandt (Alexandre Korda, 1936) et Rembrandt (Hans Steinhoff, 1942) partagent le mythe commun de Rembrandt artiste maudit. Le Rembrandt de Korda est un artiste indépendant et tolérant, reconnu et respecté par ses pairs jusqu'à sa mort malgré son statut financier précaire, un caractère relativement stable. Davantage encore que dans le roman, le film anglais montre que, par sa marginalité, l'artiste est mieux compris par la communauté juive d'Amsterdam, en particulier son ami Menasseh que par une société de bourgeois intolérants et incultes.
Le Rembrandt de Steinhoff est bien plus sombre et violent, un caractère en formation dans une certaine tradition goethéenne, peu compatible avec la constance de l'affirmation de soi propre au mythe. Le film installe une forte portion d'antisémitisme et d'antiféminisme. Cependant ce mythe, dont le fondement est la représentation de l'autonomie de l'art par rapport aux champs politique, religieux et économique, et de l'indépendance de l'artiste par rapport à la masse et aux puissants, entrave de facto le développement du discours totalitaire.
La manière dont Rembrandt justifie sa composition de La Ronde de nuit diverge dans les films anglais et allemand : Charles Laughton dit qu'il voulait juste peindre une compagnie en branle; plus ambitieux, Ewald Balser proclame la prééminence du tout sur la partie, conformément à une tradition holiste bien allemande : "Ce n'étaient pas les individus qui comptaient pour moi, c'était la totalité !". Il est évident que le film de Steinhoff repose sur une analogie entre le destin de Rembrandt et celui du peuple allemand: tenir malgré tout et faire confiance à la volonté qui nous gouverne. Rembrandt est aussi ce que les Allemands ont appelé un Durchhalte film, un film pour tenir.
François Genton note que, dans les biographies postérieurs de Rembrandt à l'écran, Rembrandt fecit 1669 (Jos Stelling, 1977), se concentre sur la vie privée et familiale du peintre jusqu'à sa mort -de Sakia à Tatia, la fille de Titus, qui naquit peu après la mort du fils de Rembrandt et avant celle du peintre. On découvre ici un être égoïste et taciturne, peu capable d'empathie, entièrement occupé de son travail et de son œuvre, dans une société dure aux pauvres et aux faibles. Par son réalisme historique ce film néerlandais a voulu rompre avec le mythe Rembrandt qui continue toutefois de marquer la vision de l'artiste dans l'imaginaire collectif : plusieurs décennies plus tard, malgré d'éclatantes différences, les films de Charles Matton (Rembrandt, 1999) et de Peter Greenaway (La ronde de nuit) se réfèrent encore à la thèse de l'artiste maudit.
2 - Les tableaux en dehors du contexte biographique
Les tableaux de Rembrandt sont cités trois fois chez Jean-Luc Godard dans Les carabiniers (1966), Passion (1982) et Spot of the 22nd Ji.hlava IDFF (2018)
 |
 |
| Autoportrait aux deux cercles, 1665 |
Les carabiniers Jean-Luc Godard, 1966 |
 |
 |
| La ronde de nuit, 1642 |
Passion, Jean-Luc Godard, 1982 |
 |
 |
| Jeune femme se baignant dans la rivière, 1654 |
Spot of the 22nd Ji.hlava IDFF Jean-Luc Godard, 2018 |
Jon Amiel utilise la valeur marchande d'un tableau de Rembrandt pour en faire l'objet du vol lucratif d'une de ses toiles
 |
 |
| Bethsabée au bain 1654 |
Haute voltige (Jon Amiel, 1999) |
Dans Rembrandt (2025), films mêlant les genres du fantastique, du documentaire scientifique et du drame sentimental, Pierre Schoeller fait littéralement parler trois tableaux de Rembrandt de la National Gallery pour les relier au thème principal du film : la nécessité de sortir de l'entre-soi scientifique et d'envisager des ruptures possibles dans notre façon de penser. Le tout avec un maître mot, tiré de Saint Paul, l'humilité.
Est affirmé dès le générique le rôle d'encouragement à agir de Hendrikje par l'insert sur ses yeux. Dans la nuit, elle est la dernière des trois à intervenir, en contrechamp au visage de Claire. Lors de la seconde visite, c'est elle qui, par le changement de focale, semble encourager Claire à se rapprocher du vieil homme.
 |
 |
Le vieil homme dans un fauteuil est la victime du "crime", du crime d'écocide sans doute. C'est lui qui interpelle en premier Claire dans la chambre, c'est de lui qu'elle se rapproche avec compassion, c'est lui qui va mourir.
 |
 |
Saint Paul est le tableau vu en majeur dans la salle 22, lorsque le couple se rate une première fois et lorsque la lumière est éteinte sur la salle 22. Puis ses mains dirigent celles de Claire dans la nuit. Enfin, il approuve par sa présence dans la profondeur de champ le geste de compassion de Claire. Il sera aussi la dernière vision, brouillée mais lumineuse, de Claire avant de s'évanouir après avoir reposé le tableau.
 |
 |
Bibliographie :1
 |
François Genton. La biographie de peintre, un genre politique ? Les films Rembrandt d’Alexander Korda (1936) et de Hans Steinhoff (1942) p. 41 à 56 dans Biographies de peintres à l’écran. Patricia-Laure Thivat (dir.). Presses Universitaires de Rennes (novembre 2011). Collection : Le Spectaculaire Cinéma. |