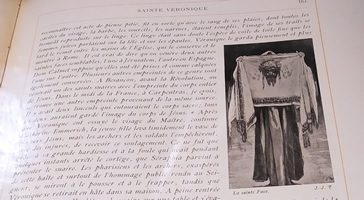|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Musée d'Orsay 28 septembre 2021- 16 janvier 2022 |
 |
Cette exposition ne s'attache pas tant à montrer que le cinéma arrive enfin comme la machine la plus apte à capter la modernite. Il est juste cet art qui arrive à point nommé pour rassembler tous les publics autour d'une culture urbaine fascinée par le mouvement des êtres et des choses. Le cinéma est le grand art populaire qui fait de la modernité un spectacle, qui existe certes depuis 1833 et l'invention de la photographie mais qui ne devient populaire et art de masse qu'en 1907 avec la création des grandes salles de cinéma confortables.
L'exposition fait dialoguer la production cinématographique française des années 1895-1907 avec l’histoire des arts, depuis l’invention de la photographie jusqu'aux premières années du XXe siècle, au fil de quelques grands sujets que sont la fascination pour le spectacle de la ville, la volonté d’enregistrer les rythmes de la nature, le désir de mise à l’épreuve et d’exhibition des corps, le rêve d’une réalité « augmentée » par la restitution de la couleur, du son et du relief ou par l’immersion, et enfin le goût pour l’histoire. Elle se conclut vers 1906-1907 alors que la durée des films s’allonge, les projections se sédentarisent dans des salles et les discours s’institutionnalisent. Le cinématographe devient le cinéma, à la fois lieu et loisir de masse.
C’est une balade nonchalante et joyeuse, impressionniste et surprenante, au cœur du monde des arts de la fin du XIXe siècle. Cet art qui, selon les mots de Charles Baudelaire, voulait « restituer le transitoire, le fugitif, le contingent » (Le Peintre de la vie moderne, 1863).
Prologue : La vie même

En 1895, les frères Lumière inventent le Cinématographe, appareil d’enregistrement et de projection de «photographies animées». Autour de 1906-1907, émerge le cinéma, loisir de masse avec ses salles de spectacle dédiées. Mais c’est au XIXe siècle, dans le contexte d’une nouvelle France urbaine, industrielle et « moderne », que des femmes et des hommes, marqués par un sentiment d’accélération du temps et la conscience accrue de la mobilité du monde, poursuivent ce que l’on pourrait appeler un rêve de cinéma : pouvoir saisir et restituer la réalité telle que nous la percevons, en mouvement, mais aussi en couleur, en relief et sonore. En un mot, faire de la vie un spectacle.
Le cinéma, par l’entremise de Georges Méliès, en 1896, s’est précocement emparé du mythe grec de Pygmalion et Galatée. Dans les Métamorphoses (Ier siècle après J.-C.), Ovide raconte l’histoire d’un sculpteur, Pygmalion, qui a réalisé en ivoire la statue d’une femme si belle qu’il en tombe amoureux et confie à la déesse de l’amour Aphrodite le souhait de trouver une épouse aussi parfaite. Son voeu est exaucé et alors qu’il embrasse sa sculpture, celle-ci s’anime.
Comment dire mieux cette fascination pour la mise en mouvement de l’inanimé et ce désir d’incarner la vie dans l’image ? Au XIXe siècle, différents spectacles et récits réactualisent ce vieux rêve de l’humanité, comme le tableau vivant ou la pantomime...
Si c’est bien le progrès technologique qui permet enfin l’animation de l’image, le cinématographe choisit le prétexte de l’art classique et du mythe pour mettre en scène sa capacité à représenter la vie comme aucun autre médium avant lui. Rodin dans Pygmalion et Galatée (1889, Musée Rodin) traduit le passage du marbre à la chair vivante par la métamorphose de l’informe marmoréen en forme humaine. Méliès fragmente au contraire la figure de Galatée. Le sculpteur amoureux tente d’embrasser sa créature facétieuse qui se dérobe à ses étreintes. Le cinématographe s’enrichit du mythe, mais il les popularise jusqu’à la satire parfois. La trivialité cinématographique imprègne le mythe. Cette « impureté » est pour Méliès au fondement de l’art du film.
La photographie tente aussi, dès les premiers daguerréotypes, de se jouer de l’incertitude entre la vie et sa représentation illusionniste, notamment à travers les portraits post-mortem, mais c’est le cinématographe qui semblera en mesure de parfaire cette illusion.
1 - Le spectacle de la ville

Sous le Second Empire, Paris se métamorphose « à vue d’oeil » en une métropole monumentale où circulent toujours plus vite les flux de marchandises et de personnes. Capitale de divertissements en tous genres et lieu de consommation de masse, couverte d’affiches, de réverbères ou d’architectures éphémères, elle devient une « ville lumière » mais aussi une « ville écran », un spectacle sans cesse renouvelé.
Dès le milieu du XIXe siècle, les artistes et les photographes veulent capter et restituer « le transitoire, le fugitif, le contingent », selon les mots de Baudelaire (Le peintre de la vie moderne, 1863). Se glissant dans les habits du bourgeois à son balcon, du flâneur des boulevards ou du badaud, ils adoptent de nouveaux points de vue. Le regard mobile des personnes et l’agitation aléatoire des rues sont rendus par des effets de perspective accélérée, de ruptures d’échelles entre les plans, de décentrements et de cadrages découpant abruptement les figures sur les bords.

Berthe Morisot, 1871

Gustave Caillebotte, 1877

Gustave Caillebotte, 1877

Guiseppe De Nittis, 1877

Jules Adler, 1877
Morisot dont le sexe et la position sociale empechent de peindre dans le coeur battant de la ville, choisit un point de vue en hauteur et un effet panoramique sur la Paris. Habitant à Passy, elle represente la capitale depuis les jardins de la colline du Trocadéro. l'inhabituelle disposition des lignes et des formes dans l'espace, les couleurs claires nous font voir le monde d'un oeil presque "naïf", comme celui de l'enfant au premier plan.
Dans une métropole en pleine métamorphose Caillebote s'intéresse aux interactions entre la population et la nouvelle architecture comme ces deux hommes qui observent le sepctacles des locomotives de la gare saint Lazarre à tarvers le treillis des poutrelles mettaliques du Pont de l'Europe. Le cadrage insolite qui coupe un personnage sur la bord de l'image vise à donner un effet de réalisme et de naturel à al scene en suggerant le mouvement incessant des passants
Cette oeuvre évoque un point de vue privilégié pour la contemplaction urbaine, le balcon de l'appartement de Caillebotte, situé boulevard Haussmann. Cette audacieuse vue d'en haut, le cinéma y aura souvent recours pour affirmer un parti pris : une vision large emabrssant toutes les directions possibles
Jules Adler represente souvent des foules manisfestant selon une composition qui privilégie l'occupation en diagonale de la toile étangeant ainsi habilement le passage du lointain au gros plans. Ce procédé sera abondemment repris pour processions et autres cortèges filmés.

Le cinématographe, produit de cette culture de la modernité et machine vouée à l’enregistrement de la vitesse, fait de la « capitale des arts » un sujet de prédilection. La fixité du cadre des premiers films Lumière qui perpétuent cette iconographie urbaine les assimile encore à des peintures ou à des photographies (on parle alors de « photographies animées »). Mais, il est aussi héritier d’une lignée d’attractions toujours plus immersives : panoramas, dioramas, aquariums, musées de cire… ambitionnant d’inviter plus encore le spectateur dans l’image.
Cinématographe Lumière - La Foule après le cortège (1900) ; Nuages sur Paris (1900), Place Bellecour (1896),Panorama des rives de la Seine (1897)
2 - Mouvements de la nature

Les recherches des artistes et des savants traduisent des sensibilités et des préoccupations nouvelles. C’est l’animation du monde en son entier, visible et invisible, dont l’évidence est interrogée. La saisie photographique bouleverse la représentation du réel : de l’infiniment grand à l’infiniment petit, des profondeurs sous-marines à celles du corps humain, du mouvement perpétuel des astres à celui, grouillant, des micro-organismes, ce qui échappait à la perception commune est observé, analysé et partagé. Résultant d’un procédé mécanique, la photographie est considérée comme le moyen de reproduction le plus fiable. Ce médium révolutionnaire fournit un formidable répertoire de procédures et d’effets optiques (flou, découpage séquentiel, surimpression, instantané, montage, projection dans l’obscurité) que les peintres et sculpteurs s’approprient.

Gustave Caillebotte, 1892
Il n'est pas d'usage au XIXe siècle de traiter d'un sujet aussi quelconque, une corde à linge, dans un tel format. Et pourtant le sujet est hardi puisqu'il s'agit pour Caillebotte de peindre l'air. Pour rendre cet effet de vent, l'artiste multiplie les coups de pinceau et les oriente en tous sens. Parmi les réactions bien connues des spectateurs des premières projections Lumière se retrouve la même fascination pour l'enregistrement le plus exacte des manifestations "complexes" de la nature (physiques des fluides et de l'air) comme celui des feuilles des arbres à l'arrière-plan du Repas de bébé
Les premiers films tournés en extérieur, appelés « vues de plein air » par Méliès, se concentrent sur des motifs récurrents : fumées, nuées, éclairs, mers déchaînées. Comprendre et fixer sur la toile, la plaque ou la pellicule les mouvements des êtres, des choses et des éléments est la grande affaire de cette fin de siècle.
À l’instar du cinéma, articulant les contraires entre l’observation scientifique du fonctionnement du monde et sa restitution sensible, les créateurs de l’Art nouveau et la danseuse Loïe Fuller, convaincus des capacités émotionnelles de la ligne serpentine, génèrent des formes inédites : ils cristallisent dans la matière ou figurent par la danse le sentiment vitaliste de la croissance et les cycles de la vie.
Alice Guy : Baignade dans un torrent (1897)
3 - Du temps donné à voir

La révolution des transports, les cadences nouvelles de la fabrication des biens matériels ou encore le développement de la presse quotidienne à grand tirage transforment la perception du temps. Le surgissement des évènements et leur disparition soudaine deviennent des sujets à part entière pour la peinture, la photographie et l’imagerie populaire.
Une dimension essentielle s’impose alors à la vocation représentative des arts : la variabilité temporelle. Le dispositif du diorama qui se multiplie au cours du XIXe siècle tente d’y répondre ; une même image permettant d’alterner une vision diurne et nocturne d’un paysage.
Les possibilités sérielles de la machine photographique répondent aussi au tourment de la représentation du temps. En restituant des scènes quelconques tirées du quotidien – tels des essais d’instantanés en plongée sur l’animation d’un carrefour urbain - la photographie contribue à détourner les artistes de la représentation de l’événement historique, de l’instant prégnant, idéalisé, sacralisé dans les compositions
de la peinture d’histoire.
L’intérêt grandissant des peintres – notamment Monet et Pissarro - pour la durée les entraîne à cultiver la sensation, à traduire la nature éphémère des manifestations du réel dans des recherches audacieuses sur la couleur, déclinant en séries des variations sur un même motif.
Avec le cinématographe, le temps ne sera plus symbolisé. Il ne relèvera plus de la synthèse ni de l’intermittence, mais il sera reproduit par le défilement d’images photographiques, les photogrammes.
4 - Le corps mis à l'épreuve

La frénésie semble s’emparer des corps, à l’heure de la mise en scène des prouesses sportives et des convulsions hystériques, sous couvert d’observations scientifiques. Gesticulations, pantomimes, tics, contorsions ou déformations inspirent aux artistes et caricaturistes des audaces plastiques qui feront des organismes, des squelettes ou des carcasses les sujets principaux de l’«attraction cinéma» et des premières vues comiques produites par Pathé et Gaumont. Mécanisé par le mouvement perpétuel des phénakistiscopes ou par les chronophotographies d’Etienne-Jules Marey et Albert Londe, démembré par les prestidigitateurs et les opérateurs de films « à trucs », comme Georges Méliès et Segundo de Chomon, accéléré par les tours de manivelle des projectionnistes, le corps s’émancipe des canons traditionnels de la figuration réaliste.
Qu’il soit pathologique, excentrique, voire monstrueux, sa représentation est l’un des ressorts des films des premiers temps, lesquels enfreignent parfois la bienséance par l’obscénité des gestes et des regards, des allures et des costumes. S’il contribue à la fétichisation et à l’érotisation des femmes, le cinéma perpétue et renforce aussi la violence des stéréotypes coloniaux et racistes en se nourrissant d’« exhibitions » diverses, du barnum forain aux « villages indigènes » situés dans les expositions universelles, en passant par le Jardin d’acclimatation qui institue, en 1877, la pratique de monstration d’êtres humains.
Ces représentations spectaculaires, à logique commerciale, témoignent de l’intégration de l’Autre dans une chaîne très hiérarchisée (de la bête brute, tel le singe, à l’homme blanc au sommet, en passant par l’animal noble, comme le lion, suivi par le colonisé, l’enfant et la femme) et attirent alors un public de citadins de plus en plus nombreux.
Georges Méliès (Paris, 1861 - Orly, 1938). L’Homme à la tête en caoutchouc,
laude Monet (1840-1926). Les Déchargeurs de charbon, vers 1875. Huile sur toile, 54 × 65,5 cm. Paris, musée d’Orsay. Photo © RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Patrice Schmidt. Alexandre Promio (1868-1926). Déchargement d’un navire, vue Lumière nº 34, Espagne, 21 mai- 12 juin 1896. Collection de l’Institut
5 - Regards de voyeurs, corps de femmes

Si le terme « voyeur » apparaît dans le langage des années 1880 pour définir le regardeur, par effraction, d’un spectacle érotique, cette figure fait déjà l’objet de représentations récurrentes dès les années 1840. Les caricaturistes de la presse satirique illustrée croquent alors des hommes, au théâtre ou aux bains de mer, qui braquent lorgnettes, télescopes ou jumelles sur les corsets, les mollets ou les tenues de bain des femmes. Ils sont rejoints dès les années 1850 par les photographes qui, dans leur studio, mettent en scène des modèles féminins exhibant leur anatomie, parfois même en pleins ébats sexuels, sous le regard d’un homme toujours habillé.
Le stéréoscope, instrument de visionnement binoculaire à pratique solitaire, « pour voir les dames de près », redouble le dispositif voyeuriste. Il oblige le consommateur de ces images vendues sous le manteau à pencher ses « yeux avides » sur deux « trous », selon l’anathème de Baudelaire lancé contre la photographie. L’appareil apporte profondeur et volume aux images finement coloriées à la main, et permet de scruter les regards, les corps et les sexes dans leur singularité.
Les opérateurs de films recyclent les outils de la représentation du voyeurisme photographique : trou de serrure, oeilleton, fenêtre dans un paravent, loupe, télescope ou jumelles. Par la vertu du montage alterné des plans, le spectateur observe le mateur, et aussi ce qu’il est censé voir : coucher, bain ou encore effeuillage d’une femme. Avec le cinématographe, le modèle destine sa parade érotique autant au voyeur inclus dans le champ qu’à
la caméra et… au public
Ferdinand Zecca, Pathé Frères – Ce que l’on voit de mon sixième – 1901. © Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé. - Anonyme, Pathé Frères – Five Ladies – 1900. © Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé. - Ferdinand Zecca, Pathé Frères – Par le trou de la serrure – 1901. © Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé.
6 - Une réalité augmentée

Au XIXe siècle, se développe une culture des inventions scientifiques dont le but est de s’approcher au plus près de l’illusion de la réalité et de l’expérience perceptive. Pour certains inventeurs des années 1860 comme Charles Cros ou Louis Ducos du Hauron, la quête de l’enregistrement et de la restitution du mouvement s’accompagne de celle des couleurs ou de la vision en relief.
La couleur, d’abord peinte artisanalement sur la pellicule, selon la technique utilisée pour les plaques de lanterne magique ou les photographies, est un élément à part entière de l’attraction cinématographique. Elle est vive, changeante et surnaturelle plutôt que réaliste, et pleinement « moderne », comme celles des nouveaux colorants industriels, des feux d’artifice, de la chromolithographie ou des éclairages électriques de la danseuse Loïe Fuller.
Si le cinéma en trois dimensions ne voit le jour qu’au siècle suivant, des expérimentations visent à adapter la stéréoscopie au cinématographe ou à animer des anaglyphes. Comme en peinture, de nombreux films suggèrent le relief par des effets de trompe-l’oeil et de sujets dont la trajectoire semble devoir « crever l’écran » en s’approchant du spectateur.
Les premiers films ne sont pas non plus silencieux. Présentés en « programmes » d’une dizaine de vues et d’une trentaine de minutes commentés par des conférenciers ou « bonimenteurs » forains, ils sont aussi souvent bruités et accompagnés de musique, et même bientôt synchronisés avec des pistes de phonographes sur lesquels sont enregistrées les plus célèbres voix des artistes de la Belle Époque.
Léon Belly (1827-1877). Pèlerins allant à La Mecque, 1861. Huile sur toile, 161 x 242 cm. Paris, France, musée d’Orsay. © RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / Hervé Léwandowski. Alexandre Promio (1868-1926). Caravane de chameaux, vue Lumière n°407, 1897. Collection de l’Institut Lumière. Photo : © Institut Lumière.
7 - L'histoire en tableaux

Dès 1896, le cinématographe s’attache à raconter des histoires en proposant de courts films historiques ou religieux. Ceux-ci font appel à la culture visuelle et à l’imaginaire collectif de la période, dominés par les reproductions des oeuvres de peintres académiques tels Delaroche ou Gérôme, par les bibles illustrées de Doré ou Tissot, ou encore par les derniers grands succès de la peinture militaire ou religieuse au Salon (Detaille, Merson), qui font l’objet de tableaux vivants ou d’adaptations théâtrales.
Tous ces artistes ont en commun un sens certain de l’invention. Ils délaissent le modèle théâtral classique de la peinture d’histoire et développent de nouvelles stratégies narratives : hors-champ, suspense, représentation de l’«instant d’après» qui inscrivent le moment représenté dans une temporalité étendue, que le cinématographe n’a plus qu’à « dérouler » à l’écran. Si les premiers réalisateurs de fictions (Alice Guy, les frères Lumière, Georges Méliès) empruntent à ces oeuvres leurs propositions narratives, ils s’en servent aussi comme documents pour imaginer les costumes et les décors.






Avec ces films mettant en scène les grands moments de l’histoire de France ou la vie de Jésus-Christ, le cinématographe s’affirme comme un médium populaire, divertissant et édifiant, qui sait flatter les sentiments patriotiques ou dévots des spectateurs. Son identité étant encore imprécise, le cinématographe se pare parfois des attributs de la peinture en installant autour de l’écran un cadre doré.
Épilogue : la salle de cinéma

Au début du XXe siècle, les projections cinématographiques sont des attractions spectaculaires, parmi d’autres, intégrées aux représentations acrobatiques ou de jonglerie et aux jeux d’illusion et de prestidigitation. Elles remplacent certains spectacles de cabaret, café-concert et music-hall passés de mode. Vers 1906-1907, le spectacle cinématographique, « ambulant », colporté par les forains, se sédentarise progressivement en s’installant dans des architectures dédiées, éclectiques et festives.
L’enjeu crucial est désormais de séduire et fidéliser un public de spectateurs socialement très divers en lui proposant des films plus longs, narratifs et régulièrement renouvelés. La location de bobines aux propriétaires de salles, instituée en 1907 par l’entreprise Pathé, transforme le «cinématographe» en profondeur : si le terme désigne d’abord un objet d’attraction foraine (un appareil de projection et des pellicules), son acception se dématérialise pour signifier une expérience temporelle et immersive, que l’on nomme aujourd’hui « cinéma ».
L’avocat et écrivain Edmond Benoit-Lévy, fondateur de l’Omnia-Pathé, la première salle parisienne véritablement consacrée au cinéma (1906), racontera : « j’ai voulu qu’un de mes actes les plus importants dans la carrière du film fût un acte de confiance : la construction d’une salle de bonne compagnie. Je pense que le spectacle des vues animées n’a rien à gagner aux établissements rudimentaires et mal tenus. Le délabrement, la saleté encouragent à accueillir des productions viles. Car je considère le cinématographe comme un moyen d’expression nouveau. »
Jean-Luc Lacuve, le 9 décembre 2021
Source : Fiche de Spectacles-sélection