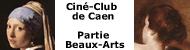|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Le néoclassicisme est un mouvement artistique qui s'est développé dans la peinture, la sculpture, l'architecture et la littérature entre 1750 et 1830 environ.

David, 1784

Antoine-Jean Gros, 1796

Marie-Denise Villers, 1799

Marie-Guillemine Benoist, 1800

Marie-Gabrielle Capet, 1808

Girodet, 1819

Ingres, 1856
Sous l'influence de Winckelmann, défenseur inconditionnel de l’art grec, qui y voit les caractéristiques absolues du beau, le néoclassicisme préconise un retour à la vertu et à la simplicité de l'antique après le baroque et les excès des frivolités du rococo des années précédentes. Cette expression nouvelle d'un style ancien voulut rallier tous les arts à ce qu'on appela alors "le grand goût". On ne jurait plus que par l'antiquité et l'on vécut à la mode de Pompéi ou d'Herculanum.
Winckelmann nait dans un milieu modeste et vit d'abord comme précepteur auprès d’enfants de familles nobles. En 1748, il se fait engager comme bibliothécaire auprès du comte Heinrich von Bünau, par ailleurs historien, dans son château de Nöthnitz près de Dresde. Après qu’il se fut converti au catholicisme, en 1754, ce dernier lui fit ouvrir les portes de la grande collection d’art du roi de Saxe à Dresde. Winckelmann publia en 1755 son premier ouvrage, Réflexions sur l’imitation des œuvres grecques dans la peinture et la sculpture. Auguste III, électeur de Saxe et roi de Pologne, lui octroya alors une pension conséquente pour continuer ses études à Rome, et étudier les œuvres d’art de l’Antiquité in situ. À Rome, il se vit proposer le poste de bibliothécaire du cardinal Albani et joua le rôle de guide pour de nombreux voyageurs venus admirer les monuments de la ville éternelle. Il devint par la suite surintendant des Antiquités puis bibliothécaire et scripteur de la bibliothèque vaticane.
Son œuvre principale est l’Histoire de l’Art de l’Antiquité (1764), dans laquelle il rejette les classifications établies par Vasari au XVIe siècle pour distinguer quatre phases dans l'art grec : le style ancien, le style élevé, le beau style et l’époque des imitateurs, qui ont toujours cours aujourd’hui (style archaïque, premier classicisme du Ve siècle, puis second classicisme du IVe, enfin style hellénistique). Il conçoit cette succession de manière cyclique, à l’image de l’évolution biologique d’un organisme vivant et valorise la période du IVe siècle av. J.-C., période qu'il considère comme l'apogée de la sculpture grecque, celle où aurait été atteint "une forme de Beau idéal jamais dépassé depuis".
Il met sa connaissance intime des œuvres, acquise notamment lorsqu’il
travaillait au Vatican et lors de ses visites des fouilles d’Herculanum
et de Pompéi, et du musée royal de Portici au service de ce
qu’il considère comme sa mission : former le goût de l’élite
intellectuelle de l’Occident. La formule qu’il trouve pour caractériser
l’essence de l’art grec, "noble simplicité et calme
grandeur", va inspirer des générations d’artistes
et d’architectes après lui comme Jacques-Louis
David, Antoine Jean Gros, Joseph-Marie
Vien, Dominique Ingres, Jean-Germain
Drouais et les premiers peintres américains venus étudier en
Europe : Benjamin West, sans oublier
les théoriciens de l’art et écrivains allemands comme Lessing,
Goethe et Schiller.

Benjamin West, 1770

John Trumbull, 1819
J.J. Winckelmann rejette la nature sensuelle de l’art, manifestation
des passions de l’âme, et invente le "beau antique" en
marbre blanc (ignorant comme ses contemporains qu’il était revêtu
de polychromie), dont l’esthétique est fondée sur l’idéalisation
de la réalité et conditionnée par la liberté politique,
la démocratie. Se basant sur les travaux du comte de Caylus en qui
il reconnut une influence importante, il contribua à faire de l’archéologie
une science plutôt qu’un passe-temps de riche collectionneur.
Les principales caractéristiques du néoclassicisme sont:
- Motifs inspirés par l'antiquité grecque et romaine
- Thème moralisateur, souvent propagandiste (particulièrement sous Napoléon), mise en avant des valeurs civiques.
- Orthogonalité générale du tableau
- Couleur locale destinée à séparer les groupes de personnages pour une grande clarté et simplification de la composition
- Dépouillement du décor, absence d'accessoires inutiles
- Représentation du moment avant l'action
Novateur un temps, le néoclassicisme va se figer dans l'académisme.