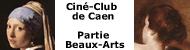|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
(1704-1788)
|
|
| Rococo |
| Portrait en pied de la marquise de Pompadour | 1755 | Paris, Musée du Louvre |
Maurice-Quentin de La Tour, naît le 5 septembre 1704 à Saint-Quentin. Troisième fils de François de La Tour, maître écrivain, ingénieur géographe et chantre de la collégiale de Saint-Quentin, et de Reine Zanar. Durant son enfance, au lieu d’écouter le professeur, il croque ses camarades et couvrait ses cahiers d’esquisses. Son frère ainé avait pris la carrière des finances et son cadet celle des armes. Au sortir du collège, à dix-huit ans, voulant devenir peintre, il quitte Saint-Quentin pour Reims, puis Cambrai, à la recherche de modèles et de maitres.
Il entre en apprentissage chez Claude Dupouch, peintre et membre de la prestigieuse Académie de Saint-Luc, à Paris, le 16 octobre 1719. En 1722, il retourne à Saint-Quentin où il entretient une liaison avec sa cousine germaine, âgée de 22 ans, Anne Bougier.
En 1725, séjournant à Cambrai, où s'est réuni le congrès destiné à réconcilier l’empereur Charles VI et le roi Philippe V d'Espagne au terme de la guerre anglo-espagnole, il est remarqué, pour le beau portrait qu’il fait d’un ambassadeur d’Espagne, par l’ambassadeur extraordinaire du roi d'Angleterre Horace Walpole, qui l’invite à le suivre à Londres et met à sa disposition une aile de son palais. En Angleterre, la fréquentation de l'aristocratie et la haute aristocratie lui apprend à connaitre la « bonne société » tout en se cultivant. Après avoir orné les salons des riches banquiers, des princes et des coquettes à la mode, ses portraits étaient passés dans l’atelier des premiers graveurs de Londres, William Sharp, Richard Earlom, William Woollett, Valentine Green, qui ont consacré leur burin à la reproduction durable des œuvres légères du pastelliste. Sa prospérité assurée, il quitte l’Angleterre en 1727 et revient en France. Il a alors vingt-trois ans.
À son retour en France, il s'installe comme peintre à Paris, où, profitant de l’anglomanie ambiante, il se fait passer pour un peintre anglais et se met, avec ses portraits, en rapport avec les personnes en crédit et avec les artistes. Rigaud, qui ne voulait se lier qu’avec des célébrités, le reçoit froidement. Largillierre, qui avait également eu sa période anglaise devient, en revanche, vite son ami, un conseiller bienveillant et un protecteur. Jean Restout, qui a été son maitre, aura une grande influence sur lui, et le met en relation avec Lemoine, Vien, Carle Vanloo, Vernet, Parrocel, Greuze. Présenté au graveur Tardieu, celui-ci le fait connaitre à Pierre Delaunay, peintre de l’Académie de Saint-Luc, marchand de tableaux quai de Gesvres, puis à Vermansal, qui le fait entrer dans l’atelier du peintre belge et ami de Watteau, Jean-Jacques Spoëde, où il fait des portraits, qui le font remarquer par Louis de Boullogne, premier peintre du roi. Ce bienveillant protecteur, qui devait mourir en 1733, lui ayant conseillé de « dessiner beaucoup », il abandonne à jamais la peinture à l’huile bien qu'il ait fait un portrait de Carle Vanloo, et une toile représentant le satyre Marsyas, pour le pastel, poudre colorée déposée sur papier, parchemin, vélin ou soie, qui doit être protégée de tout contact, technique dont la Vénitienne Rosalba Carriera avait lancé la mode en France lors de son passage à Paris en 1720. Il s’enferme pendant deux ans, de 1727 à 1729, pour ne s’occuper que de dessin, apprenant aussi les mathématiques, la géométrie, la physique, lisant les poètes. À la différence de sa devancière qui a produit des allégories et des portraits, il est exclusivement portraitiste.
Le portrait au pastel de Voltaire, qu’il réalise en 1735, lui assure une grande renommée. Agréé par l’Académie royale de peinture le 25 mai 1737, il expose pour la première fois au Salon en août-septembre de cette même année avec une effigie grandiose du président de Rieux, qui reçoit, dans son château de Passy, toute la société de l'époque, ce qui accroît sa notoriété. Le 10 mars 1745, il obtient son brevet de logement aux galeries du Louvre, en remplacement de Martinot, valet de chambre-horloger du Roi, et expose au Salon en août-septembre le portrait du Roi, celui du Dauphin, du ministre d'État et Contrôleur général Orry, ainsi que plusieurs autres portraits. Le 24 septembre 1746, il est reçu membre de l’Académie royale, avec le Portrait de Restout comme morceau de réception. Le 27 mars 1751, il est nommé conseiller de l’Académie royale, qui le désignera, le 4 août 1753 et le 24 juillet 1767, pour faire partie du comité chargé d’examiner les œuvres qui seront exposées au Salon. En août-septembre 1748, il expose 15 portraits au pastel, dont ceux du roi, de la reine et du dauphin, au Salon.
À son apogée, il réalise différents portraits de Louis XV, de la famille royale et de son entourage, et devient ainsi, après Jean-Marc Nattier, un artiste en vogue. À sa maturité, La Tour est un excellent dessinateur ; surnommé « le prince des pastellistes », il acquiert une remarquable maitrise du portrait au pastel, appliquant méthodiquement un ensemble de règles de cadrage, d’éclairage et de composition. Son succès est alors incontesté, la critique unanime, à tel point qu’il sera pris d’une ambition démesurée et rêvera de faire du pastel la technique dominante du portrait (il cherche notamment à faire de très grands formats par collage, concentre sa clientèle sur les plus hauts personnages de l’époque, monopolise le pastel dans le cadre de l’Académie royale). Il tentera de fixer le pastel pour le rendre aussi durable que l’huile (la fixation du pastel se faisait avec des laques ou des vernis : elle porte toujours atteinte à « la fleur du pastel », sa surface mate qui accroche la lumière). Son perfectionnisme méticuleux lui vaudra d’endommager certains de ces portraits. Il se permettra des provocations répétées, comme le portrait d’un esclave noir nostalgique de son pays au milieu des plus hauts dignitaires, de même qu’il affirmera souvent sa sympathie pour les idées philosophiques.
Il fréquente aussi les diners du lundi de Marie-Thérèse Geoffrin, où il rencontre Helvétius et Nollet qu’il nomme ses bons amis, Crébillon, Jean-Jacques Rousseau, Duclos, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Dupuis, La Condamine, Buffon, le maréchal de Saxe, Paulmy d’Argenson, le comte d’Egmont, le duc d’Aumont, l’abbé Jean-Jacques Huber dont il aime tant la conversation et dont il est institué légataire, l’abbé François-Emmanuel Pommyer, le financier Orry, Piron, et le violoniste Mondonville et tant d’autres. Il a une longue liaison avec la cantatrice Marie Fel dont il réalise, bien sûr, le portrait. Comme en Angleterre, il étudit la littérature, les mathématiques et la politique, afin de se trouver à la hauteur des conversations qu’il entend dans les cercles et dans les salons. Son caractère ne le conduit pas à transmettre ses connaissances. C’est sans doute Adélaïde Labille-Guiard qui, à la génération suivante, conservera le mieux son enseignement.
Lié au mouvement philanthropique des Lumières, il octroie des rentes à des institutions religieuses de sa ville natale pour leurs œuvres sociales. En 1782, il fonde une école de dessin qui existe encore aujourd'hui sous le nom d’École de La Tour. En 1784, alors qu'il est atteint de démence sénile, sa famille le fait revenir à Saint-Quentin. Après sa mort, en 1788, son fonds d'atelier et une grande partie de son œuvre sont légués à la ville de Saint-Quentin par son frère.