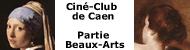|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Femmes d'Alger dans leur appartement
Eugène Delacroix, 1822
Huile sur toile 180 x 229 cm
Paris, Musée du Louvre
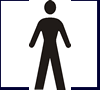
La virtuosité coloriste a fait des Femmes d’Alger un modèle pour la génération des peintres impressionnistes et néo-impressionnistes. Fantin-Latour l’a copié, Renoir l’a imité. Paul Signac l’a érigé en leçonPaul Signac a érigé ce tableau en leçon "d’application de la méthode scientifique" du contraste simultané des couleurs. Pour lui "Dans les Femmes d’Alger, le peintre ne veut exprimer aucune passion, mais simplement la vie paisible et contemplative dans un intérieur somptueux : il n’y aura donc pas de dominante, pas de couleur clef. Toutes les teintes chaudes et gaies s’équilibreront avec leurs complémentaires froides et tendres en une symphonie décorative, d’où se dégage à merveille l’impression d’un harem calme et délicieux » (D’Eugène Delacroix au néo-impressionnisme, Paris, 1911)."
 |
 |
| avant la restauration d'octobre 2021 | après la restauration d'octobre 2021 |
Peint par l'artiste au retour de son voyage en Afrique du Nord, le tableau a été acquis par l'État dès sa création en 1834. Après avoir été présenté au musée des artistes vivants (palais du Luxembourg), il est entré au musée du Louvre en 1874. Sa couche picturale est restée en bon état, sans usure et avec très peu de retouches. Mais son appréciation visuelle s’était dégradée depuis plusieurs décennies, en raison des nombreuses couches de vernis oxydés qui le recouvraient. Cet écran épais provoquait un jaunissement, un assombrissement et un aplanissement optique de la composition : les blancs, pourtant très variés, étaient ramenés à la même teinte ocre, l’opacité des vernis réduisait l’illusion de profondeur de l’espace, tandis qu’on distinguait avec peine les objets évoqués à l’arrière-plan (le meuble d’encoignure, les tissus roulés en boule, les variations du carrelage mural). L'aspect de certaines gerçures de matière a été atténué. Un nouveau vernis naturel a achevé de rendre la saturation et le contraste des couleurs.
Ce tableau inspirera Picasso en 1954-1955.

Picasso, 1955

Picasso 1955