 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Erwin Panofsky

De ce livre devenu presque légendaire, on ne sait ce qui, aujourd'hui, contribue davantage au prestige : l'intense et sombre rayonnement du sujet, qui plonge au plus profond de la civilisation occidentale et du cœur humain ; l'envergure chronologique et géographique de l'étude ; l'ampleur et la richesse d'analyses qui en font le monument le plus accompli de la méthode iconologique de E. Panofsky, laquelle consiste à déchiffrer la signification d'une œuvre d'art par l'exploration historique et culturelle de ses formes ; la constellation des trois auteurs aux noms illustres dont le concours donne un sommet d'érudition dans des domaines aussi divers que la médecine, l'astrologie, la poésie, la métaphysique, sans même parler des arts visuels. Ou bien encore l'histoire du livre qui résume à soi seule celle du XXe siècle.
Ses origines remontent en effet à 1923, l'année du putsch de Hitler à Munich, avec la publication par E. Panofsky et Fr. SaxI de Dürers «Melencolia I». Le livre étant épuisé, les deux historiens d'art s'adjoignirent, dans le cadre de la bibliothèque de Warburg, la collaboration de R. Klibansky, spécialiste de la philosophie antique et médiévale. L'arrivée de Hitler au pouvoir, l'exil obligé des auteurs interrompirent le travail. Puis vint le bombardement de Hambourg qui détruisit l'original allemand de l'ouvrage prêt à sortir dans l'été 1939. La version anglaise, autrement dit le nouvel original, ne put paraître qu'en 1964.
Elle comprend quatre parties. La première, «La notion de mélancolie et son évolution historique», traite de la mélancolie dans la littérature physiologique des Anciens et dans la médecine, la science et la philosophie du Moyen Âge. La deuxième, «Saturne, astre de la Mélancolie», étudie l'idée et l'image de Saturne dans la tradition littéraire et picturale. La troisième partie est consacrée à la Melancholia generosa des Florentins du Quattrocento. La quatrième enfin s'occupe de Dürer, de sa mystérieuse gravure et de sa longue postérité.
La traduction française, prévue depuis des années, a été elle-même retardée par la perte de l'illustration d'origine, qu'il a fallu reconstituer. Les ultimes compléments de R. Klibansky en font une édition définitive.
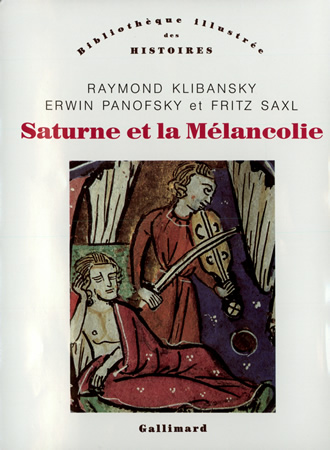
Le St. Jérôme diffère du Chevalier, la Mort et le Diable en ce qu’il oppose l’idéal de la vie contemplative à celui de la vie active dans le siècle. Mais il diffère plus fortement encore de Melencolia I , en ce qu’il oppose une vie mise au service de Dieu a ce qu’on peut appeler une vie de compétition avec Dieu; la jouissance paisible de la sagesse divine, à l’inquiétude tragique de la création humaine. Alors que le Saint Jérôme et Chevalier, la Mort et le Diable illustrent deux manières dissemblables de parvenir au même but, le Saint Jérôme et Melencolia I expriment deux aspirations antithétiques. D’ailleurs, au sein de la triade des Meisterstiche, Dürer considérait ces deux gravures comme formant pendants, car il avait coutume de les présenter ensemble, et les collectionneurs les examinaient et en discutaient en les mettant côte à côte. Six exemplaires furent ainsi cédés par paires, un seul exemplaire de Melencolia I fut cédé isolément, alors que le Chevalier, la Mort et le Diable ne changea pas une seule fois de main en compagnie de l’une ou l’autre des deux autres estampes. Les deux compositions offrent en effet des contrastes trop parfaits pour être l’effet du hasard. Alors que saint Jérôme est confortablement installé a sa table de travail, la Mélancolie ailée est assise, presque accroupie — une attitude qui rappelle celle de Job dans le Retable Jabach — sur une dalle de pierre, près d’un édifice inachevé. Alors qu’il est a l’abri dans une tiède cellule ensoleillée, elle se trouve dans un lieu froid et solitaire, non loin de la mer, par une nuit qu’éclairent faiblement la lueur de la lune — ce qu’on peut déduire de l’ombre portée sur le mur par le sablier — et l’éclat inquiétant d’une comète encerclée d’un arc-en-ciel lunaire. Alors qu’il partage sa cellule avec des animaux heureux et repus, elle n’a pour compagnie qu’un angelot morose perché sur une meule hors d’usage, qui griffonne quelque chose sur une ardoise, et par un chien famélique et frissonnant. Et, tandis que le saint s’absorbe dans ses travaux théologiques, elle est plongée dans un état d’inaction découragée. Indifférente à sa mise, les cheveux épars, elle appuie sa tête sur sa main, tandis que de l’autre main — l’avant-bras reposant sur un livre ferme — elle manie machinalement un compas. Ses yeux grands ouverts fixent sombrement le vide. L’état d’esprit de ce génie tourmenté s’exprime aussi par l’étonnant désordre des objets hétéroclites qui l’entourent — contraste supplémentaire avec l’ordre plaisant et rationnel qui règne dans la cellule de saint Jérôme. Accrochés au mur de l’édifice en construction sont une balance, un sablier et une cloche, au-dessous de laquelle est enchâssé un carré « magique » de chiffres ; une échelle appuyée contre la maçonnerie souligne l’inachèvement des travaux ; le sol est jonché d’instruments et d’outils, utilisés principalement en architecture et en charpenterie. Outre la meule déjà mentionnée, on voit : un rabot, une scie, une règle, une pince, quelques clous tordus, un gabarit à moulures, un marteau, un petit creuset (peut-être pour fondre du plomb) avec des pincettes pour tenir les charbons ardents, un encrier et un plumier et dépassant des plis de la jupe de la Mélancolie, un instrument qu’on peut identifier (en se fondant sur une xylographie de Hans Doring) comme l’embout d’un soufflet. Deux objets semblent être moins des instruments que des symboles ou des emblèmes du principe scientifique qui est a la base de l’architecture et de la charpenterie : une sphère en bois tourné et un polyèdre en pierre. Comme le sablier, la balance, le carré magique et le compas, ces emblèmes attestent que l’artisan terrestre, à l’image de l’« Architecte de l’univers », applique a son oeuvre les lois mathématiques, c’est-à-dire, dans le langage de Platon et du Livre de la Sagesse, les lois de la « mesure, du nombre et du poids ».
Dans ses acceptions modernes, la mélancolie désigne « une dépression morbide morale et physique... une humeur noire, une morne tristesse... une tendance à l’inertie et aux sombres rêveries », souvent suggérées par la désolation d’un lieu. Toutefois, à l’époque où Dürer compose sa gravure, ce mot n’a pas encore le sens d’un type de comportement passager et encore moins celui du caractère déprimant d’un environnement.
Pour comprendre le titre Melencolia I, inscrit sur les ailes d’une chauve-souris qui pousse un cri, il nous faut plutôt en revenir à la théorie des « quatre humeurs », dont nous avons déjà parie au sujet des interprétations données par Dürer du thème de la Chute de l’homme. Cette théorie, qui avait pris sa forme définitive des la fin de l’Antiquité classique, se fondait sur la croyance que le corps et l’esprit de l’homme étaient conditionnés par quatre humeurs essentielles, lesquels, à leur tour, se trouvaient associées aux quatre éléments, aux quatre vents (ou points cardinaux), aux quatre saisons, aux quatre phases de la journée et aux quatre âges de l’homme. La bile jaune (choler), correspondant au feu, était censée participer de sa chaleur et de sa sécheresse ; on l’associait donc a Euros, vent chaud et sec, à la période de midi, a la maturité virile. La lymphe, humide et froide comme l’eau, s’assimilait au vent Auster, a l’hiver, à la nuit et à la vieillesse. Le sang, humide et chaud, s’apparentait à l’air, a l’agréable Zéphir, au printemps, au matin et à la jeunesse. Enfin, l’humeur mélancolique (du grec mélas, anos, noir, et kholè, bile), liée a l’élément terre, était supposée sèche et froide, et on l’associait au rude Borée, à l’automne, au soir et à l’âge de la soixantaine. Dürer lui-même a illustré cette théorie cosmologique dans une des gravures sur bois exécutées pour Conrad Celtes, laquelle diffère de la tradition par le fait qu’il identifie l’humeur mélancolique (dite encore atrabilaire) à l’hiver et non à l’automne, alors qu’il associe l’humeur lymphatique à l’automne, au lieu de l’hiver — ce qu’on peut admettre, étant donne les différences de climat entre l’Allemagne et la Grèce ancienne.
Dans l’être humain idéal, ou parfaitement sain, ces quatre humeurs devaient s’équilibrer si parfaitement qu’aucune d’elles ne prédominait sur les autres. Mais un tel humain ne pouvait être qu’immortel et exempt de péché, et ces deux privilèges, nous le savons, nous avaient été irrémédiablement retirés en châtiment du péché originel. En réalité, donc, dans tout individu, l’une des quatre humeurs prévaut sur les autres et détermine sa personnalité. Compte tenu que chacune de ces humeurs s’affirme, d’une façon très générale, selon les saisons de l’année, les phases de la journée et les âges de l’homme — on continue à évoquer le « sang vif de la jeunesse » ou la «mélancolie de l’automne » — chacun, homme, femme ou enfant, est, de par sa constitution, soit sanguin, soit cholérique, soit mélancolique, soit lymphatique.
Ces quatre types diffèrent les uns des autres de tous les points de vue possibles. Chacun d’eux se distingue par une constitution physique particulière — élancée ou trapue, sensible ou rude, robuste ou délicate ; par sa couleur de cheveux, d’yeux et de peau (le mot.« complexion » dérive d’un mot latin qui signifie « mélange humoral », ou « tempérament » ; en anglais, il désigne également le « teint ») ; par sa vulnérabilité à certaines maladies spécifiques ; et, surtout, par ses caractéristiques morales et intellectuelles. Le lymphatique est enclin à d’autres vices — et, à l’inverse, susceptible d’autres vertus — que le cholérique ; il se comporte différemment avec ses semblables ; il est doué pour une catégorie différente de professions ; il a, enfin, une philosophie de la vie différente. Tant que la prédominance d’une quelconque de ces humeurs reste dans des limites raisonnables, l’esprit et le corps de l’individu sont seulement caractérisés d’une certaine façon.
Mais si cette humeur prend sur lui une emprise incontrôlable — soit par suite d’une augmentation quantitative, due à nombre de raisons, soit par une dégradation qualitative, entraînée par inflammation, refroidissement ou « corrosion » — il cesse d’être un lymphatique ou un mélancolique «normal» ; il tombe malade et peut en mourir. Bien entendu, on ne considérait pas les quatre humeurs, ou tempéraments, comme également souhaitables. Le tempérament sanguin, associé à l’air, au printemps, au matin et à la jeunesse, passait — et, dans une certaine mesure, passe encore — pour le plus favorisé. Solidement bâti et le teint coloré, le sanguin semble surpasser tous les autres types par sa gaieté naturelle ; il est, plus que les autres, sociable, généreux et doué de toutes sortes de talents ; même ses défauts, un certain faible pour le bon vin, la bonne chère et pour l’amour, sont plutôt sympathiques et pardonnables. Le sang, après tout, est plus noble et plus sain que la lymphe ou que les deux sortes de bile. Quelques théoriciens, on s’en souvient, soutenaient que le tempérament sanguin était la condition originelle, parfaitement équilibrée, de l’homme ; et même après la destruction de cet équilibre idéal par la faute d’Adam, la prédominance du sang sur les autres humeurs paraissait toujours préférable. Autant la complexion sanguine avait bonne réputation, autant la complexion mélancolique semblait la pire, la plus haïssable et la plus redoutée. Si elle se trouvait en excès, ou enflammée, ou affectée de quelconque façon, elle provoquait la démence ; cette maladie, dont tous peuvent être atteints, les mélancoliques y étaient spécialement prédisposés. Même en l’absence d’un trouble pathologique déclaré, les gens d’un naturel mélancolique — généralement considérés comme pessime complexionati (du pire des tempéraments) — passaient pour malchanceux et déplaisants. Maigre et noiraud, le mélancolique est, disait-on, « maladroit, avare, rancunier, avide, méchant, lâche, infidèle à sa parole, irrévérencieux et endormi ». D’autres le jugeaient « désagréable, triste, oublieux, paresseux et apathique » ; il fuit ses semblables et méprise le sexe opposé ; le seul trait qui le rachète — encore est-il fréquemment passé sous silence dans les textes — est une certaine inclination à l’étude solitaire.
Avant Dürer, les représentations de la Mélancolie se trouvent principalement, premièrement dans les traités de médecine ; deuxièmement, dans les livres populaires ou les feuilles volantes consacrés à la théorie des quatre humeurs, en particulier, dans les calendriers et almanachs manuscrits ou imprimés. Dans les manuels de médecine, la mélancolie est considérée comme une maladie, et les illustrations ont pour but de montrer les différentes méthodes de traitement — par la musique, par la fustigation, par l’application de cautères. D’autre part, les estampes, les calendriers et les Complexbüchlein populaires décrivent le mélancolique non comme un cas pathologique, mais comme un type humain. Il apparaît dans l’une des quatre figures, ou des quatre scènes, destinées à faire ressortir les traits plus ou moins recommandables, mais toujours dans les limites de la parfaite normalité, des Quatre Tempéraments. Nous disons « quatre figures ou quatre scènes », car, de ces Quatre Tempéraments, il existe, d’une façon générale, deux sortes de représentations, l’une purement descriptive, l’autre illustrant une action. Dans les images de type descriptif (dont l’origine remonte aux cycles hellénistiques qui dépeignent les Quatre Ages de l’homme), chaque tempérament s’incarne dans une figure isolée. Ces quatre figures — habituellement à pied, mais parfois à cheval — montrent des différences d’âge, de statut social et de profession. Une gravure sur bois allemande, par exemple, symbolise le tempérament sanguin par un jeune et élégant fauconnier, qui marche sur des nuages et des étoiles, pour souligner son affinité avec l’élément Air. Le lymphatique — toujours difficile à caractériser, parce que, justement, de par son humeur vague, il manque de caractéristiques — apparaît sous les traits d’un bourgeois bien nourri, debout sur un étang, et tenant un chapelet à la main. Le cholérique est un homme belliqueux d’une quarantaine d’années, qui s’avance dans les flammes ; irascible, il brandit une épée et un tabouret. Le mélancolique, enfin, a l’aspect d’un vieil avare morose, debout sur la terre ferme ; s’appuyant contre un meuble verrouillé, dont le dessus est presque couvert de pièces de monnaie, il soutient sombrement sa tête de la main droite, tandis que la gauche serre une bourse pendue à sa ceinture. Dans les illustrations de type scénique, les divers tempéraments sont interprétés par des couples. On note, en général, quelque indication des éléments correspondants, mais les personnages eux-mêmes ne sont pas différenciés quant à l’âge, le statut social, la profession. Ils ne révèlent leur tempérament que par leur comportement, et il est intéressant d’observer que, ce faisant, ils reprennent des rôles inventés, à l’origine, pour caractériser des vices. Au cours de la seconde partie du Moyen Age, on ne s’intéressait pas aux types de comportement humain en tant que tels, mais seulement du point de vue de la théologie morale ; ils ne sont pas traités dans les écrits ou les représentations profanes, et ils n’apparaissent, sous les traits des Vices, que dans les sculptures de cathédrales comme celles de Chartres, de Paris ou d’Amiens, ou dans les miniatures de traités de morale, comme la Somme le Roi.
Vers la fin du Moyen Age se dessine une tendance à transformer ces personnifications morales en spécimens de caractérologie, et le jugement de valeur de bien ou de mal s’atténue progressivement et finit par disparaître. De nombreux traits décrits dans les Contes de Canterbury de Chaucer dérivent des exemples condamnables invoqués dans des sermons des XIIè et XIIIè siècles, et un grand nombre des « fous » de la Narrenschyff de Sebastian Brant avaient été, à l’origine — et, dans l’esprit aigri de l’auteur, étaient toujours — de répréhensibles pécheurs. Ainsi, lorsqu’un artiste du XVè siècle cherche des modèles pour une représentation non descriptive, mais scénique, des Quatre Tempéraments, il n’a d’autre choix que de se référer aux types traditionnels des Vices. C’est ainsi que les interprétations scéniques du tempérament sanguin, telles qu’on les trouve dans plusieurs manuscrits à peintures et divers calendriers imprimés, s’inspirent d’illustrations de la Luxure. Comme dans le bas-relief de Luxuria, à la cathédrale d’Amiens, le type sanguin est personnifié par un couple étroitement enlacé . De même, le tempérament cholérique se reconnaît dans un homme qui frappe une femme à coups de poing et à coups de pied, ce qui est la simple adaptation d’une sculpture de la cathédrale d’Amiens représentant la Discorde.
Comme, dans la littérature populaire médiévale, les caractéristiques principales de la mélancolie sont la morosité et la somnolence, ce sont les allégories de la Paresse, ou Acedia, qui servirent de modèle pour ce tempérament ; Dürer, on s’en souvient, y avait lui-même recouru dans le Songe du docteur. Cette représentation se fonde sur l’idée que le sommeil est un péché: elle montre un paysan endormi près de sa charrue, un bourgeois endormi près d’un crucifix alors qu’il devrait prier (fig. 199), une femme endormie près de sa quenouille (fig. 197). Cette dernière image est même si populaire que Sebastian Brant l’adopte pour personnifier sa Fulheit (Paresse), en y ajoutant un détail sadique : la fileuse négligente se brûle la jambe pendant son sommeil. En conséquence, les interprétations scéniques de la Mélancolie se composent d’une femme endormie avec sa quenouille, auprès d’un homme endormi à une table (fig. 198) ou même au lit ; parfois, l’homme s’est endormi sur un livre, et, dans d’autres exemples, au couple fainéant est adjoint un ermite, humble personnification de l’étude et de la solitude. Si blasphématoire que cela puisse paraître, il faut compter ces images simplistes au nombre des sources de la célèbre gravure de Dürer . Pour rudimentaires qu’elles soient, elles ont fourni l’idée de base de la composition et l’idée générale d’inertie chagrine. Il s’agit toujours d’une femme placée en évidence au premier plan, avec, en position diagonale, un représentant du sexe opposé, de moindre importance, et, dans tous les cas, la caractéristique majeure de la figure principale est son inaction. Mais les similitudes, cela va sans dire, sont peu de chose en regard des différences. Dans les miniatures et les gravures sur bois du XVè siècle, la figure secondaire est aussi endormie et paresseuse que la principale, alors que Dürer établit un contraste délibéré entre l’attitude prostrée de la Mélancolie et l’application concentrée de l’angelot qui griffonne. Et, ce qui est plus important, c’est pour des raisons totalement opposées que la Mélancolie est oisive et que les femmes des images populaires ont abandonné leur quenouille. Ces humbles créatures se sont endormies par pure paresse, alors que la Mélancolie, au contraire, se trouve dans un état, pour ainsi dire, de super-éveil, et son regard fixe est celui de la quête intellectuelle, intense bien que stérile. Elle a suspendu son travail non par indolence, mais parce que ce travail est devenu, à ses yeux, privé de sens. Ce n’est pas le sommeil qui paralyse son énergie, c’est la pensée. Dürer transfère ainsi le concept de mélancolie sur un tout autre plan que celui de ses prédécesseurs. Nous sommes en présence non d’une ménagère négligente, mais d’un être supérieur — supérieur, non seulement parce qu’il est ailé, mais surtout en vertu de son intelligence et de son imagination — entouré des instruments et des symboles de l’effort créateur et de la recherche scientifique. Et, ici, nous percevons un second et plus subtil courant de tradition, qui s’intègre au contenu de la composition de Dürer . A partir du milieu du XIIè siècle — le portail Royal de Chartres en constituant le premier exemple connu — on voit se multiplier les personnifications des Arts. Limité à l’origine aux Sept Arts libéraux aristocratiques énumérés par Martianus Capella, leur cercle s’élargit bientôt à un nombre moins défini d’« Arts mécaniques », de manière à illustrer la définition que les aristotéliciens donnent de l’art : «tout effort productif fondé sur un principe rationnel ». Ces images obéissent à une formule constante : une figure féminine incarnant l’un des arts — ou, à l’occasion, l’art en général — parfois accompagnée d’assistants ou de personnifications subordonnées, est entourée des attributs de son activité et tient elle-même à la main le plus représentatif. Une miniature du XIVè siècle — l’un des rares exemples de l’« Art en général » (fig. 201) — montre une femme littéralement cernée par des outils et instruments scientifiques et techniques de toutes sortes. Et, lorsque ces objets en viendront à être dispersés dans un espace à trois dimensions au lieu d’être superposés sur une surface plane, l’effet général commencera à se rapprocher de celui de Melencolia I. De cette dernière œuvre, il existe d’ailleurs un antécédent iconographique assez précis. Dans les éditions de 1504 et 1508 de la Margarita Philosophica de Gregor Reisch — l’un des traités encyclopédiques les plus lus de l’époque — on trouve une gravure sur bois intitulée « Typus Geometriae » (fig. 200), qui rassemble déjà presque tous les objets figurant dans Melencolia I de Dürer . Dans la personnification de la Géométrie se réalise la synthèse des symboles des Arts libéraux et de ceux des Arts mécaniques, ou techniques, car elle tend à montrer que presque tous les métiers de création et de nombreuses branches de la « philosophie naturelle » (ou sciences de la nature) reposent sur des opérations géométriques. La Géométrie, sous les traits d’une dame richement vêtue, est occupée à mesurer une sphère avec un compas. Elle est assise à une table sur laquelle sont des instruments de traçage, un encrier et des modèles de corps stéréométriques. En petite échelle, un contremaître vérifie les travaux d’un édifice inachevé, et l’on voit une pierre de taille encore dans la pince d’une grue. Deux autres aides travaillent sur une aire de dessin et font un relevé topographique. Sur le sol gisent un marteau, une règle, deux gabarits à moulures ; dans le ciel, des nuages, la lune et les étoiles (annonçant le phénomène céleste de la gravure de Dürer) sont observés au moyen d’un quadrant et d’un astrolabe. Non seulement la météorologie et l’astronomie — allusion supplémentaire à celle-ci : la plume de paon qui orne le chapeau de la Géométrie, le plumage ocellé du paon étant un antique symbole du firmament étoile — mais aussi tous les arts techniques sont ainsi interprétés comme des applications de la géométrie : conception que Dürer fait sienne. Son Underweysung der Messung («Instructions pour mesurer »), il le dédie « non seulement aux peintres, mais aussi aux orfèvres, sculpteurs, maçons, charpentiers et à tous ceux qui font usage de la géométrie » ; et, dans un projet, probablement rédigé vers 1513-1515, il mentionne ensemble « le rabot et le tour » — dont le fonctionnement se fonde sur un principe géométrique — de même que le rabot et la sphère en bois tourné sont juxtaposés dans Melencolia I. En fait, tout le matériel réuni dans la gravure pourrait se placer sous la rubrique « Typus Geometriae » : le livre, l’encrier et le compas se référant à la géométrie pure ; le carré magique, le sablier, la cloche et la balance, à la mesure de l’espace et du temps (« Geo ponderat», la géométrie pèse, pour citer un vieux verset mnémonique) ; les divers outils et instruments techniques, à la géométrie appliquée ; et le polyèdre en pierre, à la géométrie descriptive, en particulier à la stéréographie et à la perspective. Ainsi, la gravure de Dürer réalise la synthèse de deux formules jusqu’alors distinctes : celle des « Melancholici» des calendriers, almanachs et Complexbuchlein populaires, et celle du « Typus Geometriae » ornant les traités de philosophie et les encyclopédies. Il s’ensuit, d’une part, une intellectualisation de la mélancolie, et, d’autre pan, une humanisation de la géométrie. Le mélancolique traditionnel avait été un malheureux, avare et apathique, honni pour son humeur misanthrope et pour son incompétence généralisée. La Géométrie traditionnelle, personnification d’une science noble, avait été une figure abstraite, inaccessible à l’émotion et à la souffrance. Dürer, lui, imagine un être réunissant la puissance intellectuelle et les dons techniques d’un « Art », et pourtant en proie au désespoir sous l’effet de l’« humeur noire». Il représente une Géométrie devenue mélancolique, ou, en d’autres termes, une Mélancolie dotée de tout ce qu’implique le mot géométrie — en bref, une Melancholia artificialis, une mélancolie de l’artiste. Ainsi, presque tous les motifs utilisés dans la gravure de Dürer peuvent se justifier par des traditions textuelles ou iconographiques bien établies, relatives à la « mélancolie », d’une part, et à la « géométrie », de l’autre. Mais l’artiste, bien que pleinement conscient de leur valeur emblématique, les a en outre chargés d’une signification expressive, ou psychologique. Nous avons déjà observé que l’arrangement, ou plutôt le dérangement des instruments et symboles des professions « géométriques » créait une impression de malaise et de stagnation mentale. La comète et l’arc-en-ciel, qui jettent sur le décor des phosphorescences inquiétantes, ne servent pas seulement à désigner l’astronomie, il s’en dégage une émanation maléfique. La chauve-souris et le chien étaient, par tradition, associés à la mélancolie : la première (vespertilio, en latin), parce qu’elle son le soir et vit dans des lieux sombres, solitaires et pourrissants ; le second, parce que, plus que les autres animaux, il est sujet à des accès de dépression, voire de folie, et que plus il est intelligent, plus son expression est désolée («Les chiens les plus sagaces sont ceux qui promènent avec eux la face la plus mélancolique », dit un auteur du début du XVIè siècle, en songeant probablement à quelque épagneul). Mais, dans la gravure de Dürer, la chauve-souris et le chien, plus que des emblèmes, sont des créatures vivantes, dont l’une pousse un cri de mauvais augure, et l’autre se couche en rond misérablement. Ce qui est vrai des objets et figures accessoires ne l’est pas moins de la personnification principale. Le livre et le compas font partie des attributs de la Géométrie, mais, signe de son accablement profond, elle ne se sert ni de l’un ni de l’autre. Elle appuie sa tête sur sa main, conformément à une tradition qui remonte à l’art de l’Egypte ancienne. Cette attitude, manifestation de rêverie morose, de lassitude, de chagrin, celle de centaines et de milliers de figures, était devenue inévitable dans les représentations de la mélancolie et de la paresse (fig. 193, 194, 197, 198, 203). Même le fait que Melencolia appuie sa tête sur son poing fermé n’est pas aussi inhabituel qu’on pourrait le croire. Le pugillum clausum est un symbole typique de l’avarice, et Dante dit que les avares ressusciteront « col pugno chiuso » (le poing fermé) ; on assurait même que, si ce vice mélancolique était poussé jusqu’à la démence, les malades ne desserraient plus jamais leur poing, parce qu’ils s’imaginaient tenir un trésor, voire le monde entier, dans leur main. Mais ce motif a, chez Dürer, une tout autre signification. Dans les miniatures médiévales, le Mélancolique exhibe son poing fermé (fig. 193) à titre d’attribut, comme saint Bartholomé montre son couteau, ou Marie-Madeleine, son vase d’onguent. En faisant reposer sur son poing la tête — centre de la pensée et de l’imagi nation — de Melencolia, Dürer transforme une caractéristique de tempérament, voire un symptôme médical en un geste expressif. Sa Melencolia n’est ni une avare ni une folle, mais un être pensant plongé dans l’incertitude. Elle ne s’accroche pas à un objet inexistant, mais à un problème insoluble. L’un des traits traditionnels du Mélancolique est son teint olivâtre, « terreux », qui peut s’assombrir parfois jusqu’à la noirceur. Cette faciès nigra hante encore Milton, lorsqu’il décrit sa « très divine Mélancolie », Whose saintly visage is too bright To hit the sense of human sight, And therefore to our weaker view O’erlaid with black, staid wisdom’s hue. (« ... dont la face sacrée est trop éclatante pour que l’œil humain puisse en soutenir la vue ; c’est donc toute noircie qu’à nos faibles sens apparaît la sagesse. ») Presque aussi subtil que Milton, Dürer remplace la coloration physique du teint par un effet de lumière. Le visage de Melencolia, comme celui du Pensieroso de Michel-Ange, est envahi d’ombre ; il est assombri plutôt que sombre, et rendu d’autant plus saisissant par le contraste du blanc des yeux. La couronne qu’elle porte est avant tout un palliatif contre les dangers de l’humor melancholicus. Pour lutter contre les effets nocifs de la «sécheresse », il était recommandé de s’appliquer sur la tête les « feuilles de plantes d’une nature aquatique », et c’est précisément de ces plantes qu’est composée la couronne de Melencolia : on y reconnaît la renoncule d’eau — qui se rencontre également dans la section « Aqua » de la xylographie cosmologique exécutée par Dürer pour Celtes (fig. 192) — et le cresson de fontaine. Mais la notion même de couronne — d’habitude, symbole de joie ou de supériorité, comme dans de nombreux portraits d’humanistes ou comme dans les représentations, par Dürer , de l’empereur Sigismond (fig. 202), d’une Vierge sage, d’Hercule (fig. 98) et du poète Térence (fig. 34) — se trouve ici démentie par l’atmosphère générale de tristesse. On voit donc de nouveau un emblème servir de support à une expression psychologique. Peut-être ne sommes-nous pas en droit de présumer que presque tous les détails de Melencolia I ont une signification particulière. Mais le choix de deux plantes insignifiantes, qui n’ont de commun que leur « nature aquatique » — Copernic croyait encore que les graines de cresson provoquaient une « humidité malsaine», parce que la plante croît dans les lieux humides — ne peut être l’effet du hasard. En outre, le propre témoignage de Dürer nous apprend que, dans le contexte de cette gravure, les accessoires les plus conventionnels et les plus ordinaires du costume d’une Hausfrau (maîtresse de maison) sont chargés d’un sens emblématique. Attachés à sa ceinture, Melencolia porte une bourse et un trousseau de clefs ; comparés à l’aspect net et ordonné de ces objets dans une gravure comme la Vierge au mur, eux aussi traduisent le désarroi de leur propriétaire, car les clefs pendent dans tous les sens, et la bourse traîne par terre, avec ses cordons de cuir emmêlés et en partie dénoués. Mais plus encore que de révéler une négligence découragée, qui est encore la marque du Mélancolique à cette époque, ces objets symbolisent deux concepts précis. Sur l’un des croquis préparatoires de Melencolia I se trouve la note suivante : « Schlüssel betewt gewalt, pewtell betewt reichtum. » (La clef représente le pouvoir, la bourse représente la richesse). La bourse est restée un symbole courant de richesse, surtout de ses aspects les moins plaisants que sont la parcimonie et l’avarice ; quant au «pouvoir des clefs », il est détenu par le pape, et la femme mariée allemande se voyait confier la Schlusselgewalt, dont nous avons déjà parlé à propos de la Glorification de la Vierge. La bourse est donc un attribut fréquent du Mélancolique avaricieux (fig. 194 et 203), mais les clefs, elles aussi, ont un rapport avec la mélancolie. Comme nous allons le voir, on associait l’humeur mélancolique à la planète Saturne, qui, au titre de plus vieille et de plus haute des divinités planétaires, était censée détenir, aussi bien que conférer, le « pouvoir ». D’ailleurs, on la représentait parfois avec une clef ou un trousseau de clefs. Toutefois, comme la Melencolia de Dürer n’est pas une Mélancolie ordinaire, mais, selon notre expression, une Melancholia artificialis, une Mélancolie de l’artiste, on peut se demander s’il n’existe pas un rapport particulier entre les attributs du pouvoir et de la richesse et l’activité artistique professionnelle. Cela semble bien être le cas. Dans ses écrits théoriques, Dürer affirme que la richesse doit, ou devrait être, la récompense méritée de l’artiste (son premier projet, composé vers 1512, se termine sur cette phrase : « Si tu es pauvre, tu peux atteindre une grande prospérité par le moyen d’un tel art »). Il utilise aussi le mot allemand Gewalt, pouvoir, dans le sens spécifique d’une maîtrise consommée, but ultime de l’artiste, qui ne s’obtient que par un travail passionné et par la grâce de Dieu : « Et les véritables artistes reconnaissent au premier coup d’œil si une œuvre est puissante [gewaltsam] ou non, et un grand amour naîtra dans le cœur de ceux qui comprennent » ; ou encore : «Dieu donne un grand pouvoir (viel Gewalt) aux hommes de talent. » Cette maîtrise consommée résulte, selon Dürer — et selon tous les autres penseurs de la Renaissance — de la parfaite coordination de deux grands acquis : le savoir théorique, et, en particulier, une connaissance approfondie de la géométrie (Kunst, au sens original de « savoir »), d’une part, et l’habileté dans la pratique (Brauch), d’autre part. « Les deux doivent aller de pair, dit Dürer , car l’un ne vaut rien sans l’autre. » Cela explique non seulement l’état de désordre et de négligence des clefs et de la bourse de Melencolia — ce qui indique moins une présence de richesse et de pouvoir que leur absence temporaire — mais aussi le contraste significatif que forme sa torpeur oisive avec l’activité fébrile de l’angelot. Mûrie et savante, Melencolia personnifie la Connaissance théorique, qui pense, mais ne peut agir. Le petit enfant ignorant, penché sur son ardoise, absorbé dans des griffonnages dénués de sens et qui donne presque l’impression d’être aveugle, personnifie l’Habileté pratique, qui agit, mais ne pense pas. (Notons en passant que le mot Kunst, choisi par Dürer pour désigner le savoir théorique est du genre féminin, alors que le mot Brauch, la pratique, est masculin.) Ici, (théorie et pratique ne vont pas « de pair », comme le demande Dürer ; elles sont totalement désunies, et il n’en résulte qu’impuissance et pessimisme. Trois questions restent à élucider. D’abord, de quel droit Dürer substitue-t-il un -drame spirituel à la représentation coutumière d’un tempérament inférieur, d’humeur : obtuse et paresseuse ? Deuxièmement, sur quoi s’appuie-t-il pour associer, et même identifier, l’idée de mélancolie à celle de géométrie ? Enfin, troisièmement, quelle est la signification du « I », qui suit le mot « Melencolia » sur le cartouche que déploient les ailes de la chauve-souris ? La réponse à la première question réside dans le fait que Marsile Ficin, la personnalité dominante de l’académie néo-platonicienne de Florence, avait révisé, ou plutôt inversé, tout le concept de la « mélancolie ». Développée dans ses « Lettres », puis formulée de façon concluante dans son traité De Vita triplici, la doctrine de Ficin avait connu un grand succès en Allemagne comme en Italie. Koberger avait édité les « Lettres », et les deux premiers livres des trois Libri de Vita avaient même été traduits en allemand. De tout cela, Dürer est certainement informé, car il cite les «idées platoniciennes » dès 1512. Étant lui-même de constitution délicate et de disposition mélancolique, Marsile Ficin essayait de soulager les malaises réels ou imaginaires attribués à son « humeur » par des procédés que sanctionnait la tradition — quelque exercice physique, une vie réglée, un régime alimentaire prudent — et aussi par la musique. (A ce propos, Dürer , lui aussi, préconise les « joyeux accents du luth », dans le cas où « un jeune peintre se trouverait surmené, ce qui peut entraîner une augmentation excessive de son humeur mélancolique ».) Mais Ficin avait découvert une consolation plus efficace dans un discours d’Aristote, qui, bien que cité à l’occasion par les philosophes scolastiques, n’avait jusqu’alors en rien modifié l’antipathie et la crainte qu’inspirait généralement la mélancolie. Selon cette brillante analyse de ce qu’on peut appeler la psycho-physiologie de la grandeur humaine (Problemata, XXX, 1), le « mélancolique de nature » — à bien distinguer du véritable fou — se caractérise par une sensibilité particulière, qui tantôt exacerbe et tantôt paralyse ses pensées et ses émotions, et peut, si elle n’est maîtrisée, déboucher soit sur le délire, soit sur la totale faiblesse d’esprit; il marche, en quelque sorte, sur une crête étroite, entre deux abîmes. Mais, pour cette raison même, il marche à un niveau bien supérieur à celui des autres mortels. S’il réussit à se maintenir dans une juste mesure, « le comportement de son anomalie devient admirable d’équilibre et de beauté » (comme le dit élégamment Aristote) ; il reste sujet à la dépression ou à la surexcitation, mais il surpasse tous les autres hommes : «Tous les êtres véritablement hors du commun, que ce soit dans le domaine de la philosophie, de la conduite de l’État, de la poésie ou des arts, sont des mélancoliques — certains même au point qu’ils souffrent de troubles provoqués par la bile noire. » Les néo-platoniciens de Florence eurent tôt fait de discerner dans cette doctrine aristotélicienne le fondement scientifique de la théorie platonicienne de la « fureur divine ». L’effet de l’humeur mélancolique, comparé par Aristote à celui d’un vin capiteux, semblait expliquer, ou du moins accompagner, ces extases mystérieuses qui « pétrifient le corps et le laissent presque sans vie, alors qu’elles transportent l’âme ». L’expression furor melancholicus en vint à devenir synonyme de furor divinus. Ce qui avait été une calamité ou, sous sa forme atténuée, une tare, se transforma en un privilège, dangereux certes, mais d’autant plus révéré : le privilège du génie. Cette idée était totalement étrangère au Moyen Age, où les hommes pouvaient devenir des saints, mais non des philosophes ou des poètes « divins ». Une fois qu’elle eut repris du lustre sous les auspices conjoints d’Aristote et de Platon, la mélancolie, jusque-là tenue dans le mépris, s’auréola de sublime. Actions d’éclat ou chefs-d’œuvre impliquaient immanquablement l’intervention de la mélancolie : on a même dit de Raphaël qu’il était «malinconico come tutti gli huomini di questa eccelenza ». Bientôt, le principe aristotélicien selon lequel tous les grands hommes étaient des mélancoliques s’exagéra en l’affirmation que tous les mélancoliques étaient des grands hommes : «Malencolia significa ingenio » (la mélancolie dénote le génie), selon l’expression d’un traité, qui s’efforce de démontrer l’excellence de la peinture par le fait que les meilleurs des peintres sont tout aussi mélancoliques que les poètes et les philosophes. Comment s’étonner, dès lors, que les gens désireux de faire figure dans le monde se soient appliqués à « apprendre à être mélancoliques » — comme le dit un personnage de Ben Jonson — avec autant d’ardeur qu’ils en mettent de nos jours à apprendre à jouer au tennis ou au bridge. Le comble du raffinement est atteint par le Jacques de Shakespeare, qui, par snobisme, arbore le masque d’un mélancolique pour dissimuler qu’il est lui-même, en réalité, un authentique mélancolique. La célébration humaniste de la mélancolie s’accompagna, presque nécessairement, d’un autre phénomène : l’ennoblissement humaniste de la planète Saturne. En tant que corps physiques, les sept planètes passaient pour être déterminées par les mêmes quatre combinaisons de caractéristiques que les éléments terrestres ; mais, en tant qu’entités sidérales, elles conservaient les traits spécifiques et les pouvoirs des divinités classiques dont elles portaient le nom. Elles pouvaient donc être mises en corrélation avec les quatre tempéraments, et l’on trouve déjà, dans des documents arabes du IXè siècle, un système complet de correspondances. Le tempérament sanguin était associé à l’aimable Vénus (considérée moite et tiède comme l’air) ou, plus souvent encore, au non moins équanime et bienveillant Jupiter ; le tempérament cholérique, à l’ardent dieu Mars ; le tempérament lymphatique, à la Lune, que Shakespeare appelle encore « thé watery star » (l’étoile des eaux) ; et le tempérament mélancolique — comme on l’a déjà mentionné — à Saturne, l’antique dieu de la terre. L’adjectif « saturnien » est parfois synonyme de mélancolique, et, dans la gravure sur bois allemande citée plus haut comme exemple des illustrations « descriptives » des Quatre Tempéraments (fig. 194), l’appréciation peu flâneuse du Mélancolique se termine par ces mots : « Satumus und herbst habent die schulde » (la faute en est à Saturne et à l’automne). Une fois établie, cette « consonance » entre la mélancolie et Saturne ne fut plus jamais mise en question. Tout être humain ou animal, tout végétal ou minéral estimé de nature mélancolique — par exemple, le chien et la chauve-souris — se trouvait ipso facto sous la dépendance de Saturne. L’attitude de la tristesse, la tête appuyée sur la main, est mélancolique aussi bien que saturnienne, et, de même qu’on jugeait la bile noire la plus vile des quatre humeurs, de même, parmi les influences astrales, celle de Saturnus impius était tenue pour la plus néfaste. Saturne, maître de la plus haute des planètes, doyen des dieux de l’Olympe et ancien souverain de l’âge d’or, pouvait distribuer pouvoir et richesses. Mais Saturne, planète sèche et glacée, dieu-père cruel et détrôné, castré et incarcéré dans les entrailles de la terre, se trouvait aussi associé à la vieillesse, aux infirmités, au chagrin, à toutes sortes de malheurs, et enfin à la mort. Même dans des circonstances favorables, les natifs de Saturne ne pouvaient être riches et puissants qu’aux dépens de la générosité et de la bonté d’âme, et ils ne pouvaient être sages qu’aux dépens de leur bonheur. Normalement, leur lot était de besogner durement comme paysans ou comme ouvriers travaillant la pierre ou le bois — Saturne ayant été un dieu de la terre — de nettoyer les latrines, de creuser les tombes, d’être infirmes, mendiants ou criminels (fig. 203). Les néo-platoniciens de Florence, toutefois, découvrirent que Plotin et ses disciples avaient eu, de Saturne, une aussi bonne opinion qu’Aristote, de la mélancolie. Comme ce qui est plus haut est plus « élevé » que ce qui est plus bas, et comme celui qui engendre est plus près de la source de toutes choses que celui qui est engendré, Saturne fut décrété supérieur à Jupiter, sans parler du reste des planètes. Il symbolisa l’« Esprit » du monde, alors que Jupiter n’en était que l’« Ame » ; il était l’« inventeur » de ce que Jupiter n’avait qu’appris à gouverner ; en bref, il représentait la pensée, la plus haute contemplation, en ce qu’elle s’oppose à la simple action pratique. Ainsi interprétée, la domination de Saturne fut reconnue bien volontiers par ceux « dont l’esprit est enclin à la contemplation et à la recherche des choses les plus élevées et les plus secrètes » ; ils le saluèrent comme leur protecteur céleste, de même qu’ils se réconcilièrent avec leur humeur mélancolique terrestre. Les membres les plus illustres de l’académie de Florence — parmi lesquels Marsile Ficin, Pic de la Mirandole et Laurent le Magnifique — se traitaient entre eux, à demi par jeu, de « saturniens », et, à leur immense satisfaction, ils découvrirent que Platon, lui aussi, était né sous le signe de Saturne. Cette réhabilitation philosophique n’arrivait tout de même pas à ébranler la croyance populaire, qui tenait toujours Saturne pour la plus néfaste des planètes ; et Ficin lui-même, dont l’horoscope montrait « Sacumum in Aquario ascendentem », vivait dans une anxiété perpétuelle. Il prenait toutes les précautions possibles et recommandait à ses érudits collègues d’en faire autant. Il utilisait lui-même et conseillait des talismans astrologiques capables de contrecarrer l’influence de Saturne en invoquant le pouvoir de Jupiter, et cela, soit dit en passant, explique le carré magique qui figure dans Melencolia I de Dürer . On y reconnaît la mensula jovis à seize cases, laquelle, gravée sur une plaque d’étain, doit « changer le mal en bien » et « chasser les soucis et les craintes ». Malgré tout, Ficin se soumit courageusement à sa destinée saturnienne : « Non seulement ceux qui cherchent refuge auprès de Jupiter, mais aussi ceux qui, d’un cœur ardent et sincère, se consacrent à cette contemplation divine dont Saturne est le signe, échapperont aux influences pernicieuses de ce dernier et ne profiteront que de ses bienfaits... Pour les esprits qui demeurent dans les sphères du sublime, Saturne lui-même est un père bienveillant [juvans pater, c’est-à-dire, Jupiter], » C’est cette conception nouvelle et suprêmement humaniste de la mélancolie et du génie «saturnien » qu’exprime la gravure de Dürer. Mais, pour en venir à la deuxième de nos questions, quelle relation spécifique existe entre la mélancolie et Saturne, d’une part, et, de l’autre, la géométrie et les arts géométriques ? Nous avons déjà signalé qu’à Saturne, dieu de la terre, on associait le travail de la pierre et du bois ; l’une des plus anciennes représentations de ce qu’on peut appeler les professions saturniennes, les fresques du « Salone » de Padoue, montrent déjà le maçon et le charpentier, encore considérés comme d’humbles ouvriers manuels. Mais, au titre de dieu de l’agriculture, il revient aussi à Saturne de superviser « les mesures et les quantités des choses », et, en particulier, la répartition des terres. C’est là précisément le sens premier du mot (dérivé du grec) « géométrie », mesure de la terre, et c’est pourquoi, dans plusieurs manuscrits du XVè siècle, les attributs rustiques de Saturne se complètent d’un compas (fig. 204). Jacob de Gheyn, dans une de ses plus remarquables gravures, devait donner une dimension monumentale à ce concept de Saturne-Géomètre (fig. 205). Un ou deux de ces manuscrits du XVè siècle ajoutent l’explication suivante : « La planète Saturne nous envoie les esprits qui nous enseignent la géométrie. » Et, dans un calendrier publié à Nuremberg juste un an après Melencolia I, on peut lire : « Saturnus...bezaichet aus den Künsten die Geometrei. » (Parmi les arts, Saturne indique la Géométrie.) Outre cette relation astrologique entre la géométrie et Saturne, il existait, entre la géométrie et la mélancolie, une relation psychologique beaucoup plus subtile, qu’avait brillamment exposée le grand philosophe scolastique du XIIIè siècle, Henri de Gand (dit Goethals). Reconnaissant en lui un « esprit frère », Pic de la Mirandole, dans son Apologia de Descensu Christi ad Inféras, avait abondamment cité et approuvé l’analyse de la mélancolie due au célèbre théologien. Pour résumer son argumentation, disons qu’il existe deux sortes de penseurs. D’une part, il y a les esprits philosophiques, qui n’ont aucune difficulté à appréhender des notions purement métaphysiques, telle l’idée d’un ange ou l’idée du néant extérieur à l’univers. D’autre part, il y a ceux chez qui « la faculté imaginative prédomine sur la faculté cognitive » ; ils « n’acceptent une démonstration que dans la mesure où leur imagination peut la suivre... Leur intellect est incapable de transcender les limites de leur imagination... et ne peut concevoir que la grandeur dans l’espace [magnitudo] et ce qui a une place et une position par rapport à cette grandeur... Quoi qu’ils pensent, ils le pensent comme une quantité ou comme se situant dans une quantité, ainsi qu’il en est du point. Ces hommes sont donc mélancoliques, et deviennent d’excellents mathématiciens, mais de très mauvais métaphysiciens, car la portée de leur pensée ne va pas au-delà de ce qui est position et grandeur spatiale, lesquelles sont les fondements des mathématiques. » Les mélancoliques sont donc doués pour la géométrie — la définition donnée par Henri de Gand limitant le champ des mathématiques à une science de situs et magnitudo — parce qu’ils pensent en termes d’images mentales concrètes et non de concepts philosophiques abstraits ; à l’inverse, les esprits doués pour la géométrie sont nécessairement mélancoliques, car la conscience qu’ils ont de l’existence d’une sphère qui leur est inaccessible les fait souffrir d’un sentiment d’enfermement spirituel et d’insuffisance. C’est précisément ce que semble éprouver la Melencolia de Dürer . Ailée, mais tapie sur le sol ; couronnée, mais environnée d’ombre ; munie des instruments de l’art et de la science, mais plongée dans une rêverie désœuvrée, elle donne l’impression d’un être créateur réduit au désespoir par la conscience des barrières insurmontables qui le séparent de régions plus hautes de la pensée. Serait-ce pour souligner qu’il s’agit là du premier ou du plus bas degré des aspirations et réalisations humaines que Dürer a ajouté le chiffre « I » à l’inscription ? Il est improbable que ce chiffre se rapporte au « premier » des quatre tempéraments, car on imagine mal que l’artiste ait projeté trois autres gravures du même genre, et il est non moins difficile de trouver une suite des Quatre Humeurs qui commencerait par la Mélancolie. Le chiffre « I » se réfère donc peut-être à une échelle idéale de valeurs plutôt qu’à une séquence d’estampes — conjecture que corrobore, sans la démontrer, la source littéraire la plus importante de la composition de Dürer : le De occulta philosophia de Cornélius Agrippa de Nettesheim. Tel qu’il a été publié en 1531, ce livre célèbre semble sorti du cabinet du Docteur Faust : de plan confus, il est rempli de formules cabalistiques, de tables astrologiques et géomantiques et d’artifices de magie. Toutefois, sa version originale de 1509-1510 — dédiée à un ami de Pirckheimer, l’abbé Trithemius de Wurzbourg — qui circulait sous forme manuscrite parmi les humanistes allemands, était beaucoup plus courte et beaucoup plus « sensée ». Elle ne représente à peu près que le tiers de la version imprimée, et l’importance déjà sensible que l’auteur accorde à la magie ne l’empêche pas d’exposer un système clair et, d’une certaine façon, cohérent de philosophie naturelle. S’inspirant largement de Marsile Ficin, Agrippa reprend la doctrine néo-platonicienne des forces cosmiques, dont le flux et le reflux unifient et vivifient l’univers, et il s’efforce de montrer comment l’action de ces forces permet à l’homme non seulement de pratiquer une magie légitime — qui n’a rien de commun avec la nécromancie ni avec le commerce avec le Démon — mais aussi de réaliser ses plus hautes conquêtes spirituelles et intellectuelles. L’homme atteint à ces sommets grâce à l’« inspiration » d’en haut (notons au passage que Dürer , lui aussi, parle des « öbere Eingiessungen »), et cette inspiration peut lui parvenir de trois manières : par des rêves prophétiques, par la contemplation intense, et par le furor melancholicus dû à l’influence de Saturne. Dans la version originale du De occulta philosophia d’Agrippa, cette théorie du génie mélancolique — plus tard arbitrairement insérée dans le Premier Livre de l’édition imprimée — se trouve exposée vers la fin du dernier livre, marquant ainsi la culmination de tout l’ouvrage. Celui-ci, à l’évidence, dérive des Libri de Vita triplici de Marsile Ficin : des phrases entières y sont reprises presque mot pour mot. Mais Agrippa diffère de Ficin sur un point important, et c’est en cela qu’il se révèle comme l’intermédiaire entre Ficin et Dürer . Ficin s’intéresse peu à la politique et nullement à l’art. Le génie ne se manifeste essentiellement pour lui que chez les studiosi et les literati (les érudits et les lettrés), et la mélancolie créatrice saturnienne est une prérogative des théologiens, des poètes et des philosophes. Seule la faculté purement métaphysique, et donc la plus haute de toutes, l’«esprit » intuitif (mens), est sensible à l’influence inspiratrice de Saturne. La « raison » discursive (ratio), qui règne sur le domaine de l’action politique et morale, est dans la dépendance de Jupiter ; et l’« imagination » (imaginatio), qui guide la main des artistes et des artisans, est dans celle de Mars ou du Soleil. Mais, selon Agrippa de Nettesheim, c’est sur chacune de ces trois facultés que l’inspiration saturnienne (furor melancholicus) peut s’exercer, en les stimulant et en les portant à un degré d’activité extraordinaire, voire « surhumain ». Agrippa distingue ainsi trois sortes de génies, qui tous agissent sous l’influx de Saturne. Ceux chez qui l’« imagination » l’emporte sur l’« esprit » ou sur la « raison » deviennent de merveilleux artistes et artisans, tels les peintres et les architectes ; et, s’ils sont favorisés du don de prophétie, leurs prédictions ne porteront que sur les phénomènes naturels (« elementonirn turbationes temporumque vicissitudines »), tels que « tempêtes, tremblements de terre et inondations, épidémies, famines et autres catastrophes du même ordre ». Ceux chez qui prédomine la « raison » discursive deviennent des hommes de science, des physiciens ou des hommes d’État pleins de ressources, et leurs prédictions ont trait aux événements politiques. Ceux enfin chez qui l’« esprit » intuitif surpasse toutes les autres facultés pénètrent les secrets du divin et excellent dans tout ce qu’implique le mot théologie ; ils prophétisent les crises religieuses telles que l’apparition d’un nouveau prophète ou d’une foi nouvelle. À la lumière de ce système, la Mélancolie de Dürer, la « mélancolie de l’artiste», peut en effet se classer comme Melencolia I. Comme elle habite la sphère de l’« imagination » — par définition, la sphère des quantités spatiales — elle incarne la première ou la moins élevée des formes du génie humain. Capable d’inventer et de construire, elle ne peut penser, comme le dit Henri de Gand, que « dans la mesure où son imagination marche de pair avec sa pensée », et le monde métaphysique lui reste inaccessible. Même si elle s’aventure à prophétiser, elle s’en tiendra aux perturbations du monde physique ; les inquiétants phénomènes célestes qui, dans la gravure, rendent le ciel et la mer phosphorescents, pourraient donc non seulement indiquer l’astronomie, mais aussi évoquer précisément les « elementorum turbationes » dont parle Agrippa, et les arbres entourés d’eau du paysage pourraient suggérer ces « inondations » figurant expressément au nombre des calamités naturelles prédites par le mélancolique «imaginatif » — lesquelles, d’ailleurs, étaient censées être déclenchées par Saturne ou par les comètes saturniennes. Ainsi, la Melencolia de Dürer se range parmi « ceux dont la portée de la pensée ne dépasse pas les limites de l’espace ». Son inertie est celle d’un être qui renonce à ce qu’il peut atteindre, parce qu’il ne peut atteindre ce à quoi il aspire. L’influence de Melencolia 1 de Dürer — la première représentation qui élevait le concept de mélancolie, du niveau du folklore scientifique et pseudo-scientifique, jusqu’au plan de l’art — s’étendit à l’Europe tout entière et dura plus de trois siècles. La composition en fût parfois simplifiée, parfois encore plus compliquée, et le contenu en fût soit réintégré dans la lignée des traditions antérieures — comme ce fut le cas de la plupart des variations dues aux artistes septentrionaux du XVIè siècle — soit transposé et accommodé selon le goût et la tournure d’esprit des pays et des époques. Vasari traita cette gravure de façon mythologique, et Cesare Ripa lui fit subir une transformation emblématique ; Melencolia s’anima d’une émotion déclamatoire dans les œuvres d’artistes baroques comme le Guerchin, Domenico Feti, Benedetto Castiglione ou Nicolas Chaperon, qui souvent la fusionnèrent avec des allégories alors en vogue de la Précarité, tout en essayant de flatter l’engouement populaire pour les ruines ; elle devint sentimentale dans l’art anglais du XVIIIè siècle ; elle s’alanguit, romantique, dans l’esprit de J. E. Steinle et de Caspar David Friedrich ; et elle inspira des paraphrases poétiques et littéraires — telle celle, célèbre, de James Thompson dans Thé City of Dreadful Night — aussi bien que des tableaux, des dessins et des estampes. Le succès universel de cette gravure de Dürer n’empêche pas qu’on la reconnaisse comme une œuvre éminemment marquée par la personnalité de l’artiste. Son atmosphère de tristesse pourrait être attribuée, a-t-on dit, au chagrin que venait d’éprouver Dürer à la mort de sa mère, le 17 mai 1514 ; on a même supposé que les éléments numériques de cette date — 1, 7, 5, 15, 14 — se retrouvaient intentionnellement dans le carré magique composé de seize cases et dont la somme des chiffres de chaque ligne, même en diagonale, est toujours égale à 34. Pourtant, même si le traitement numérologique de cette date était moins arbitraire ; même si la Mensula Jovis, comme tous les autres « sceaux des planètes », ne remontait pas à des sources arabes des IXè et Xè siècles, et même si sa présence dans la gravure ne se justifiait pas par d’excellentes raisons internes — même ainsi, cette hypothèse serait difficile à admettre. Dürer respectait sa « pauvre et pieuse mère » ; en fils affectueux, il la plaignait d’avoir mené une existence si dure et l’admirait d’avoir supporté avec résignation « maintes graves maladies, une grande pauvreté, la dérision, le mépris, les paroles de raillerie, les angoisses et une succession d’autres épreuves ». Mais il est non moins certain qu’il était plus attaché encore à son père, et que ce n’est pas un deuil personnel qui l’a incité à composer une gravure si ésotérique et si lourdement chargée de concepts philosophiques. Au lieu de penser que la mort de sa mère détermina Dürer à créer Melencolia I, on aurait plutôt lieu de croire que seul un artiste qui portait en lui le projet de Melencolia était capable d’interpréter le visage d’une vieille femme comme Dürer sut le faire, lorsqu’il exécuta le portrait de sa mère, deux mois avant sa mort (fig. 206). En réalité, Melencolia I est l’émanation de la personnalité entière de Dürer plutôt que le reflet d’une émotion, si bouleversante fût-elle. Dans un dessin aquarelle de 1512-1513, fait apparemment en vue de consulter un médecin, l’artiste s’est représenté lui-même, nu, désignant une marque sur le côté gauche de son abdomen, avec cette inscription : « A l’endroit de la tache jaune, que je montre du doigt, c’est là que j’ai mal.» Le point douloureux est manifestement la rate, supposée être la source de la bile noire, cause de la maladie mélancolique. Par ailleurs, Melanchthon fait l’éloge de la «melancholia generosissima Düreri » (« la très excellente mélancolie de Dürer »), et le classe ainsi comme mélancolique, selon la nouvelle doctrine du génie. Dürer était donc, ou du moins se croyait, un mélancolique, dans tous les sens du terme. Il avait fait l’expérience des « inspirations d’en haut » et celle également de l’« impuissance » et du découragement. Mais il était aussi et surtout un artiste-géomètre souffrant des limitations de la discipline qu’il aimait par-dessus tout. Plus jeune, lorsqu’il préparait la gravure d’Adam et Eve, il avait espéré capter la beauté absolue au moyen de la règle et du compas. Mais, peu de temps avant de composer Melencolia I, il avait été forcé d’admettre ; « Mais ce qu’est la beauté absolue, je l’ignore. Nul ne le sait, si ce n’est Dieu. » Quelques années plus tard, il écrivait : « Quant à la géométrie, elle peut démontrer la vérité de certaines choses; mais, pour d’autres choses, on doit se résilier à l’opinion et au jugement des hommes. » Et encore : « Le mensonge gît dans notre entendement, et l’obscurité est si fermement retranchée dans notre esprit que même nos tâtonnements échouent. » Cette phrase, on pourrait la mettre en épigraphe à Melencolia I. Ainsi, la gravure la plus énigmatique de Dürer est-elle à la fois l’exposé objectif d’un système philosophique et la confession subjective d’un individu. En elle se confondent et se transmuent deux grandes traditions, iconographique et littéraire : celle de la Mélancolie, personnification d’une des quatre humeurs, et celle de la Géométrie, personnification d’un des sept arts libéraux. En elle s’incarne l’esprit de l’artiste de la Renaissance, respectueux de l’habileté technique, mais qui n’en aspire que plus ardemment à la théorie mathématique — qui se sent « inspiré » par les influences célestes et les idées éternelles, mais qui souffre d’autant plus de sa fragilité humaine et des limitations de son intellect. En elle enfin se résume la doctrine néo-platonicienne du génie saturnien, repensée par Agrippa de Nettesheim. Mais, en plus de tout cela, Melencolia I, en un certain sens, est un autoportrait spirituel de Dürer.


